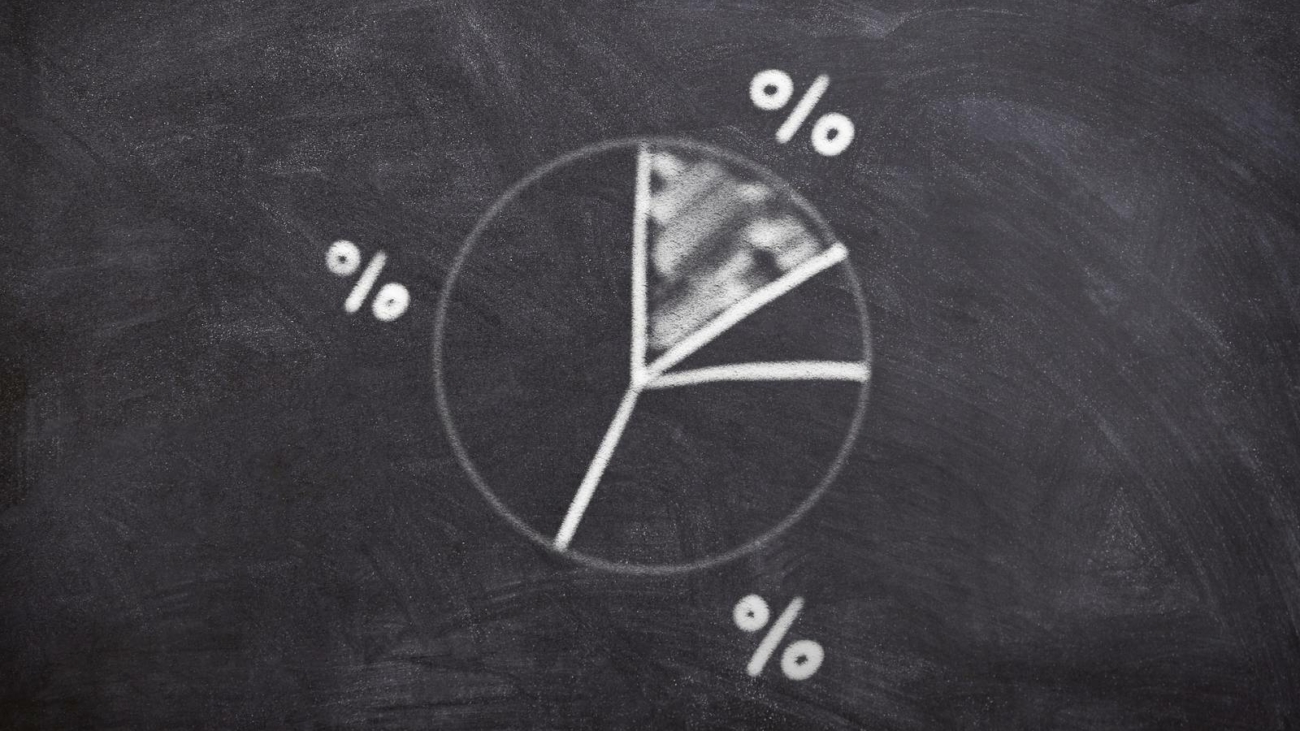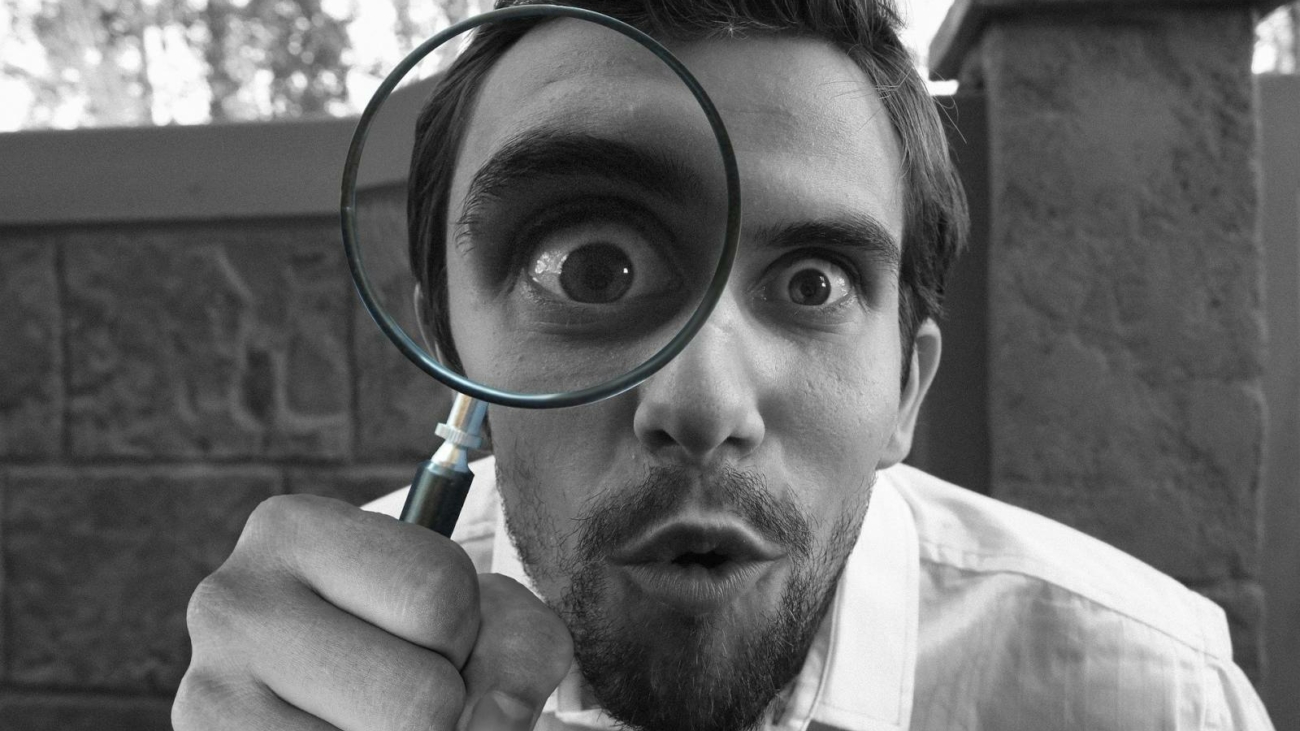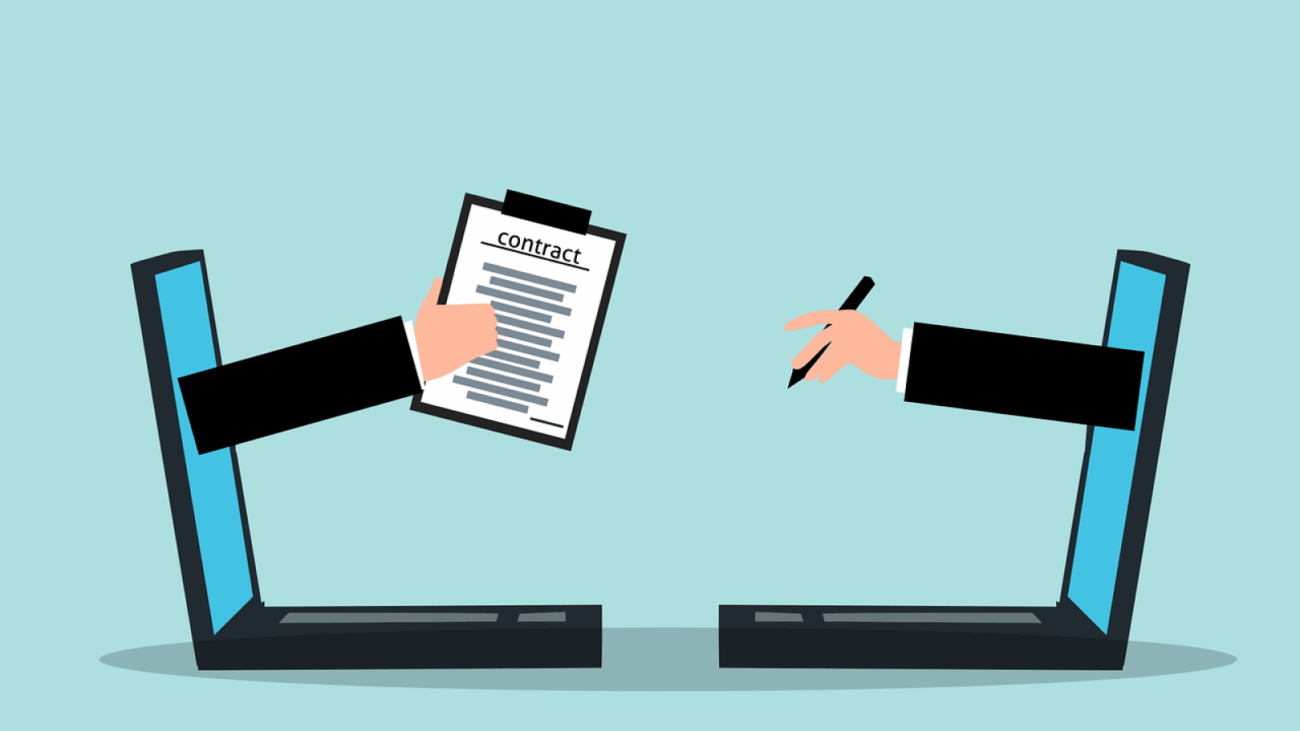Si vous êtes propriétaire d’une entreprise et que vous souhaitez divorcer, la première question que vous allez devoir vous poser c’est :
À qui appartient réellement la société : est-ce un bien propre ou un bien commun ?
En effet, le divorce peut entrainer de terribles conséquences sur l’entreprise que vous avez créée. Ainsi, s’il s’agit d’un bien commun, elle devra être partagée entre les deux époux lors du divorce.
En principe, sans contrat de mariage, tous les biens acquis pendant le mariage par l’un ou l’autre des époux appartiennent à la communauté, c’est à dire au couple. Ce sont des biens communs. Ainsi, si l’entreprise a été créée ou acquise pendant le mariage, c’est un bien commun. Elle doit donc être partagée.
Si vous avez fait un apport à une société ou un achat de parts par le biais de biens communs, vous êtes seul associé de cette société, cependant votre conjoint peut quand même revendiquer la qualité d’associé. En effet votre conjoint bénéficie d’un droit de revendication de la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites.
Toutefois, si vous avez utilisé des biens propres pour créer votre société, votre conjoint ne pourra pas revendiquer la qualité d’associé.
Qu’est-ce qu’un bien commun ?
- Vos revenus professionnels (vos salaires).
- Les biens que vous avez acquis à titre onéreux pendant la vie commune (sauf les acquisitions faites avec des sommes propres avec faculté de remploi).
- Vos revenus issus de vos biens propres (loyer issu d’un immeuble vous appartenant en propre).
- Tout bien créé pendant le mariage est un bien commun (le fonds de commerce).
Qu’est-ce qu’un bien propre ?
Si les époux se marient sous le régime de la séparation des biens, alors tous les biens acquis avant ou après le mariage sont des biens propres. De même, si les époux sont mariés sous le régime de la communauté et que les biens ont été reçus pendant le mariage par donation ou succession.
Quels sont les droits de votre conjoint s’il peut revendiquer la qualité d’associé ?
En réalité il ne disposera pas des parts mais seulement de la valeur de ces parts au moment du partage. Il convient en effet de distinguer deux choses :
- « Le titre » : la propriété des parts ou le droit d’être un associé dans la société et donc de participer au décision de la société.
Votre conjoint n’aura pas « le titre » en revendiquant la qualité d’associé. Ainsi il n’aura aucun pouvoir de décision dans votre société.
- « La finance » : la valeur du titre.
Votre conjoint s’il n’a pas le titre, aura quand même droit à la finance c’est à dire qu’il a un droit sur la valeur des parts mais pas sur les parts elles même. Vous devrez donc lui rembourser la moitié de la valeur des parts.
En réalité, le conjoint aura le droit à la moitié de la valeur de l’entreprise, peu importe qu’il ait été salarié ou collaborateur. Autrement dit, pour le dédommager, il ne sera pas nécessaire de revendre l’entreprise ou de lui céder la moitié de celle-ci. Il suffira de lui remettre une somme d’argent ou des biens représentant la moitié de la valeur de la société.
Attention, si vous ne pouvez pas faire face à cette obligation, alors vous risquez de voir votre entreprise vendue afin de pouvoir indemniser votre ex-conjoint.
Comment votre conjoint peut-il revendiquer la qualité d’associé ?
Avant le divorce :
Pour exercer son droit de revendication, votre conjoint doit notifier à la société son intention d’être personnellement associé.
-
- Si votre conjoint revendique la qualité d’associé lors de l’apport ou de l’acquisition des parts, la moitié des parts lui est attribuée sans être soumis à un agrément.
- Si votre conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de l’apport ou de l’achat il sera soumis à l’agrément des associés de la société, vous ne pourrez pas participer au vote.
Si les statuts ne comportent pas de clause d’agrément votre conjoint deviendra associé dès que la société a reçu la notification de sa revendication.
Au moment du divorce :
Votre conjoint peut exercer son droit de revendication de la qualité d’associé jusqu’à la dissolution de la communauté. En cas de divorce, la revendication est possible même au cours de la procédure et jusqu’à ce que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée
Concrètement au moment du divorce, vous conserverez la propriété des parts, et vous pouvez continuer à exercer votre activité par votre société sans que votre conjoint puisse bloquer la continuité de la société ou que vous partagiez avec lui les pouvoirs.
Cependant au stade de la liquidation, votre conjoint devra recevoir une somme correspondant à la moitié de la valeur des parts.
Comment sauver votre entreprise ?
- Si c’est un bien commun, au moment de la souscription ou de l’achat des parts vous pouvez demander à votre conjoint de renoncer à revendiquer sa qualité d’associé par écrit. Nous vous conseillons de procéder à l’enregistrement de cet écrit, voir même de la faire par acte contresigné par avocat ou acte notarié. Vous serez ainsi certain que votre conjoint ne réclame pas par la suite la qualité d’associé.
- Vous pouvez sauver votre entreprise si c’est un bien propre. En effet, l’entreprise n’a pas à être partagée et le conjoint ne peut pas demander à obtenir une part de sa valeur.
Toutefois, quand bien même la société serait un bien propre, elle peut se voir menacée dans deux cas :
- Vous pouvez avoir à payer à votre ex-conjoint une prestation compensatoire (somme d’argent versée au conjoint qui subit une baisse considérable de son niveau de vie) et si la somme est trop importante, l’entreprise peut être mise en danger car vous allez peut-être devoir revendre une partie de votre société pour faire face à votre obligation de payer.
- Si votre ex-conjoint a travaillé bénévolement au sein de l’entreprise et vous a permis de vous enrichir, il peut demander des dommages et intérêts. Les juges parlent d’enrichissement sans cause. Il constitue un motif pour demander une indemnisation représentant la rémunération que le conjoint aurait dû recevoir. Ainsi, si les indemnités à reverser sont trop élevées, vous pourrez là encore devoir revendre votre entreprise pour pouvoir payer.
Si vous avez des interrogations sur la manière de protéger au mieux vos intérêts et ceux de votre entreprise, contacter le cabinet STEFANIA, avocat droit de la famille Lyon pour vous accompagner.