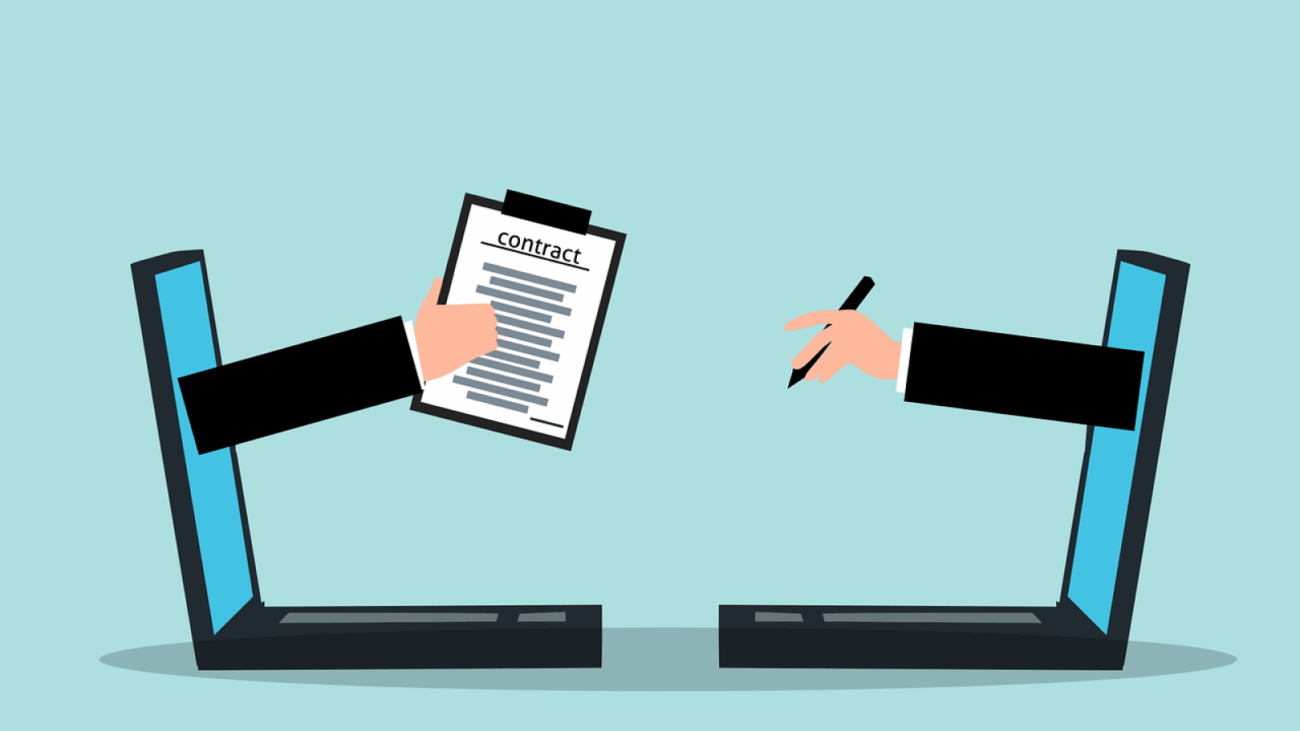Dans le cadre du dispositif de lutte contre les violences faites aux femmes, la loi tente de faciliter le recours à l’ordonnance de protection.
Vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez obtenir une ordonnance de protection.
Qu’est ce que l’ordonnance de protection ?
Le but est de protéger la victime de violences conjugales en lui accordant des mesures de protection judiciaire pour elle et ses enfants (comme l’éloignement du conjoint violent) et l’aider à se défaire de l’emprise de l’auteur en lui accordant des mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à l’attribution du logement du couple.
Comment demander une ordonnance de protection ?
L’ordonnance de protection est prévue par les articles 519 et suivants du Code civil.
Elle est sollicitée auprès du Juge aux Affaires Familiales par la victime ou avec son accord par le Procureur de la République afin de protéger en urgence la victime vraisemblable de violences conjugales tout en statuant sur les modalités relatives aux enfants et au logement.
Le législateur a souhaité, dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, réaffirmer le caractère urgent de la procédure d’ordonnance de protection. Le nouvel article 515-11 du code civil, tel qu’issu de la loi du 28 décembre 2019, dispose désormais que « l’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience».
La personne souhaitant obtenir une ordonnance de protection doit saisir le juge aux affaires familiales par requête.
La requête est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire se situant dans le ressort de la résidence de la famille ou des enfants mineurs communs. En l’absence de résidence commune et d’enfant mineur, le tribunal compétent est celui du ressort dans lequel habite le défendeur.
Le juge aux affaires familiales prononce l’ordonnance de protection « s’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés »
L’insuffisance des éléments de preuve versés au dossier constitue un motif récurrent de refus de la demande d’ordonnance de protection. Une attention toute particulière doit donc être portée à la constitution du dossier en amont de la saisine du juge.
Il convient de caractériser la vraisemblance :
– du danger auquel est exposé la victime potentielle et/ou ses enfants
– des faits de violences conjugales.
- Éléments de preuves des violences alléguées
– Les attestations et certificats médicaux (professionnels et associations).
– Les arrêts de travail et/ou bulletins d’hospitalisation.
– Les lettres, mails, sms, photos.
– Les témoignages.
– Main courante, procès-verbal de renseignement judiciaire, plainte.
– Intervention des pompiers ou des forces de l’ordre.
– Le prononcé d’une ordonnance de protection et/ou l’attribution d’un téléphone grave danger.
- Éléments liés au demandeur
– La peur exprimée par le demandeur, les risques suicidaires, la difficulté à accepter d’être protégé (l’emprise exercée par l’auteur peut freiner les démarches d’une victime de violences conjugales).
– Les menaces reçues.
– Les démarches engagées (actuelles ou passées) ou envisagées par le demandeur au niveau social, médical, juridique ou associatif.
– La situation d’isolement du demandeur.
– Un état de grossesse ou la présence d’enfants en bas âge au domicile.
– La présence d’un handicap, d’une maladie ou d’une addiction.
- Éléments liés au défendeur
– Les éléments communiqués par le parquet.
– Les antécédents judiciaires : les violences commises à l’encontre d’autres personnes ainsi que d’autres infractions (routières, contre des biens…).
– La situation actuelle (sortie d’incarcération).
– Les mesures judiciaires d’interdiction de rencontrer le demandeur.
– Le non-respect des mesures judiciaires ou alternatives à l’incarcération.
– Les conduites addictives.
– Les antécédents psychiatriques, les tentatives de suicide.
– La présence d’arme.
– Les menaces de mort proférées, les menaces de suicide.
– La surveillance exercée sur le demandeur ou les enfants (dont les cyber-violences).
– L’utilisation de la parentalité comme moyen de pression sur le demandeur (dont enlèvement, soustraction ou tentative d’enlèvement des enfants).
– La présence d’enfants communs ou non communs.
– Les modalités d’exercice du droit de visite des enfants (chez l’un des parents, espaces de rencontre ou autres).
– La fixation d’une audience à venir.
– Les risques de représailles par le défendeur, de son entourage, voire de l’entourage du demandeur.
– L’hébergement : les possibilités de relogement des deux parties hors domicile du couple, le titre d’occupation et les titulaires (bail, propriété).
– La situation d’isolement du demandeur (l’absence d’un réseau familial et amical).
– La situation de précarité dans laquelle se trouve le demandeur (sociale, professionnelle, financière).
– Le comportement du défendeur au tribunal ou à l’audience : attitude, propos dénigrants intimidation.
– Types de violences (psychologiques, physiques, économiques, sexuelles, parentalité…).
– Leur gravité et leur réitération.
– Leurs conséquences (blessures, ITT pour violences physiques ou psychologiques…).
- Une ordonnance avec date d’audience à notifier à l’adversaire
Dès qu’il est saisi de la requête, le juge aux affaires familiales rend sans délai une ordonnance fixant la date de l’audience. Cette ordonnance est notifiée à la partie demanderesse par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé.
La notification au défendeur s’effectue par voie de signification à l’initiative :
- Du demandeur lorsqu’il est assisté ou représenté par avocat
- Du greffe lorsque le demandeur n’est ni assisté ni représenté par un avocat ;
- Du ministère public lorsqu’il est l’auteur de la requête ; dans ce cas ce dernier fait également signifier l’ordonnance à la personne en danger
Depuis le décret n° 2020-841du 3 juillet 2020, entré en vigueur le 4 juillet 2020, la signification doit être faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance fixant la date de l’audience, afin que le juge puisse statuer dans le délai maximal de six jours fixé à l’article 515-11 du code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.
La copie de l’acte de signification doit être remise au greffe au plus tard à l’audience.
L’auteur des faits est l’actuel(le) ou ancien(ne) :
– conjoint(e),
– partenaire lié(e) par un pacte civil de solidarité,
– concubin(e),
– compagnon, compagne,
– petit(e)-ami(e).
Peu importe que la relation ait été épisodique ou de longue durée ni qu’ils aient, ou non, cohabité.
Dans tous les cas, sont annexées à l’ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes. Cette notification vaut convocation à l’audience fixée par le juge.
Le procureur de la République est associé à tous les stades de la procédure et peut poursuivre par la voie pénale les faits en parallèle de la procédure civile.
- L’audience devant le juge aux affaires familiales
L’audience se tient en chambre du conseil, c’est-à-dire dans le bureau du juge.
Les auditions des parties ont lieu séparément si le juge le décide ou si l’une des parties le sollicite. Cette décision fait l’objet d’une simple mention au dossier et n’est pas susceptible de recours.
- Si le juge estime que les faits sont vraisemblables, il peut prononcer une ordonnance de protection au bénéfice de la demanderesse et l’assortir des mesures qui sont
visées à l’article 515-11 du code civil.
- S’il estime que les fait ne sont pas vraisemblables ou que les conditions de l’ordonnance de protection ne sont pas réunies, il rejette la demande.
Le décret n°2020-636 du 27 mai 2020 crée une passerelle qui permet au juge, s’il estime que les conditions du prononcé d’une ordonnance de protection ne sont pas réunies, de renvoyer l’affaire à une audience dite « de fond », si les parties en font la demande. A la date de renvoi, le juge pourra statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sans qu’il soit nécessaire pour les parties de saisir le juge d’une nouvelle requête.
- Les mesures qui peuvent être prises par le juge aux affaires familiales
Le juge aux affaires familiales peut prononcer des mesures de nature variée, à savoir :
– l’interdiction d’entrer en contact avec le demandeur,
– l’interdiction pour le défendeur de se rendre dans certains lieux,
– l’interdiction pour le défendeur détenir une arme,
– la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique du défendeur ou un stage de responsabilisation
– l’attribution du logement au demandeur et la prise en charge de frais afférents,
– la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et, le cas échéant, de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants,
– l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle laquelle peut être sollicitée par le demandeur en vue d’une prise en charge des frais de procédure.
Important : Durant toute la procédure, et par dérogation aux règles de droit commun, la partie demanderesse qui craint pour sa sécurité peut demander à ce que l’adresse de son logement ou de son domicile soit dissimulée dans le cadre de la procédure civile, y compris dans l’ordonnance.
Que le demandeur soit ou non assisté par un avocat, le juge aux affaires familiales peut lui présenter une liste d’associations ou d’organismes susceptibles de l’accompagner durant la procédure.
Le juge aux affaires familiales délivre l’ordonnance de protection s’il considère comme vraisemblables les faits de violence allégués et le danger auquel la partie demanderesse ou ses enfants sont exposés.
Les mesures prononcées ont une durée maximum de six mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si le juge est saisi pendant leur durée d’application d’une requête en divorce, en séparation de corps, ou d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale.
L’ordonnance de protection est exécutoire à titre provisoire, sauf décision contraire du juge. Elle peut à tout moment être modifiée, complétée, supprimée ou suspendue.
Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison des violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République afin qu’il puisse mettre en oeuvre une mesure de protection à l’égard de ces enfants mineurs.
Sanction en cas de non-respect :
Peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (article 227-4-2 du code pénal) les mesures d’interdiction sont inscrites au fichier des personnes recherchées.
Si vous avez besoin d’un avocat pugnace et combattif offrant une prestation personnalisée et de qualité tout en vous assurant réactivité et rapidité, n’hésitez pas à contacter le cabinet de Me Marina STEFANIA, Avocat droit de la famille Lyon.