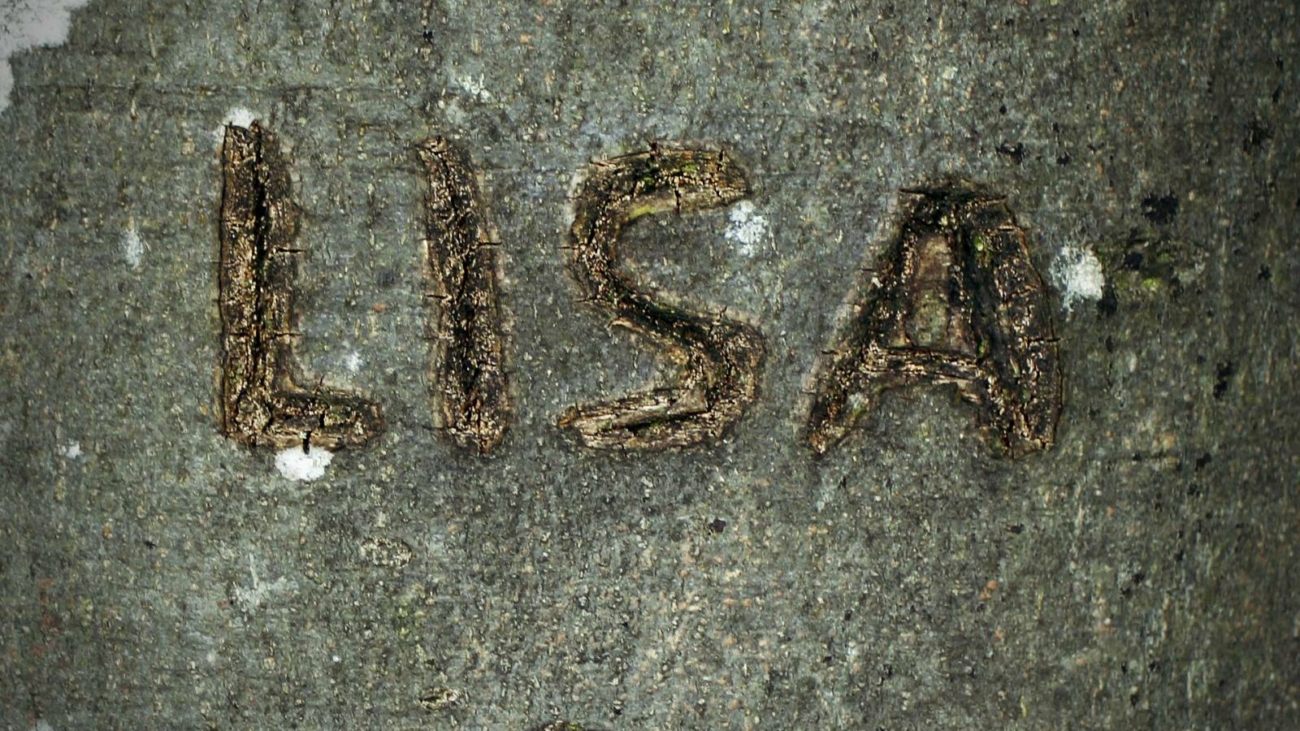Lorsque le conflit parental est trop important entre les parents et qu’il existe de surcroit un contexte de violences conjugales, il peut être opportun de solliciter l’exercice exclusif de l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant afin de pouvoir prendre toutes les décisions importantes le concernant seul.
Je vous rappelle que l’article 373-2-11 du Code civil prévoit que :
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
- 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
- Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
- L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
- Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
- Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12
- Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. »
Ainsi, à titre d’exemple, je partage la motivation d’une décision obtenue récemment en décembre 2020 du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, intervenant dans un contexte de menaces et de violences conjugales, qui a répondu favorablement à la demande de la mère non seulement de la résidence habituelle de l’enfant, âgée de 3 ans mais également de l’exercice de l’autorité parentale exclusive à son profit aux termes de la motivation suivante :
« l’absence de communication entre les parties, la discontinuité dans la prise en charge de l’enfant, les désaccords au niveau éducatif entre les parents sont préjudiciables pour le développement physique et psychique de cette petite fille.
Par ailleurs, les deux parents ont sollicité pour chacun d’eux l’exercice exclusif de l’autorité parentale, confirmant par la même qu’une co-parentalité dans l’intérêt de l’enfant est devenue impossible au regard de la dégradation de leurs relations.
La résidence de l’enfant ayant été fixée au domicile de la mère et conformément à l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale sur l’enfant sera exclusivement exercée par la mère. »
Jugement du Juge au Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse – décembre 2020
Me Marina STEFANIA, Avocat à Lyon, vous accompagne dans la préparation de votre défense pour obtenir l’autorité parentale exclusive.