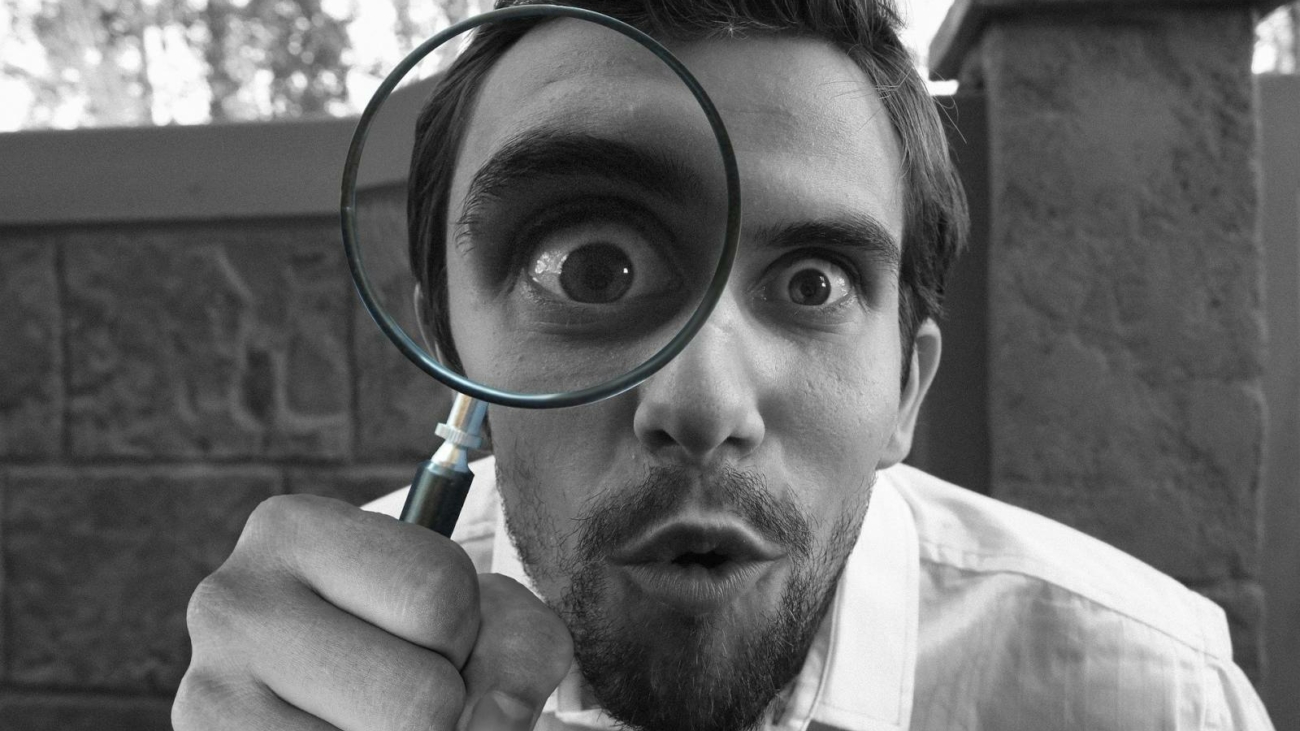Qu’appelle-t-on enlèvement international d’enfant ?
Il s’agit de l’hypothèse où l’un des parents emmène l’enfant en dehors du territoire national sans l’accord de l’autre parent qui est détenteur de l’autorité parentale conjointe et bénéficie des mêmes droits parentaux que celui qui a « kidnappé » l’enfant.
Si vous êtes confronté à ce genre de situation, comment réagir ?
Sachez qu’il n’est jamais trop tard et qu’il ne faut surtout pas abandonner.
Comment éviter le déplacement illicite de l’enfant ?
Le premier réflexe en cas de suspicion de déplacement international d’enfant à l’étranger par l’autre parent est de demander une interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents.
Il existe deux possibilités :
- Une provisoire et dans l’urgence : l’opposition à sortie du territoire par la préfecture
En cas de départ imminent, vous devez vous rendre en préfecture pour obtenir une décision en urgence du Préfet qui empêchera alors la sortie de territoire de l’enfant.
Si c’est un week-end ou un jour férié et que la préfecture est fermé, vous pouvez vous rendre au commissariat.
Il s’agit alors d’une mesure conservatoire, qui ne s’appliquera que pour une durée de 15 jours, sans prolongation possible.
La conséquence de cette mesure est la suivante : l’enfant est inscrit au fichier des personnes recherchées (FRP) et signalé au système d’information Schengen (SIS)
- Une plus pérenne : une interdiction judiciaire de sortie du territoire
Dans la mesure du possible il est préférable de solliciter une interdiction de sortie de territoire judiciaire en saisissant le Juge aux affaires familiales compétent à l’appui d’un dossier justifiant du risque de départ imminent de l’enfant avec l’autre parent.
Le Juge pourra alors rendre une décision judiciaire interdisant la sortie de territoire de l’enfant sans l’accord de l’autre parent.
Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Comment faire en sorte de faire rapatrier son enfant le plus vite possible ?
- Vous devez d’abord déposer plainte
En effet, l’enlèvement d’enfant est un délit prévu par le Code pénal.
L’article 227-5 du Code pénal prévoit ainsi que « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Les peines sont plus importantes en cas d’enlèvement international puisque l’article 227-9 du même Code prévoit que les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende :
1° Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
2° Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.
A titre d’exemple, le cabinet a eu l’occasion d’assister une personne prévenue de soustraction d’enfant par ascendant pendant plus de 5 jours (un mois et demi) en un lieu inconnu de ceux chargés de sa garde et de soustraction d’enfant et rétention hors de France (en l’espèce aux Etats-Unis) pendant 3 mois.
La personne a été reconnu coupable de ces faits par jugement du tribunal correctionnel de Versailles et condamnée à la peine d’un an de sursis probatoire pendant 3 ans avec les obligations suivantes :
-Fixer sa résidence
-L’obligation d’indemniser les parties civiles
-L’interdiction de contact avec l’enfant hors cadre fixé par le juge aux affaires familiales
La motivation du tribunal a été la suivante :
« Attendu que la seule peine adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu consiste en un emprisonnement d’une durée de douze mois.
Il résulte de la situation pénale de Mme X, qu’elle est accessible au sursis
probatoire conformément aux dispositions des articles 132-40 à 132-42 du code pénal.
Attendu qu’une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire s’impose, d’une part, eu égard à la nature et à la gravité des faits, qu’en effet la prévenue est parti avec sa fille aux Etats-Unis sans en avertir le père de cette dernière. Qu’il ressort des éléments d’enquête que la prévenue a délibérément organisé la soustraction de l’enfant alors qu’aux suite d’une ordonnance du juge aux affaires familiales le père avait la garde de cette dernière les weekends-ends et qu’une interdiction de séjour avait été prononcée. Que de nombreux moyens et investigations ont dû être déployés entre la France et les États-Unis afin de pouvoir localiser la jeune fille ainsi que sa mère et les ramener sur le sol français.
Surtout, cette même personne a été condamnée à payer à la partie civile (l’autre parent) des sommes colossales à titre de dommages et intérêts :
- 5000 euros en réparation du préjudice moral
- 15000 euros en réparation du préjudice matériel
- 16000 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale (frais d’avocat)
En effet, l’autre parent avait mobilisé plusieurs avocats sur place et aux Etats-Unis ainsi qu’un détective privé pour tenter de retrouver son enfant.
Il est donc très risqué d’opter pour un enlèvement de votre enfant.
En effet, le juge aux affaires familiales a en l’occurrence fait le choix de confier la garde au père resté sur place et la mère ne peut désormais voir sa fille que dans un espace de rencontre dédié.
En plus du dépôt de plainte, vous pouvez saisir l’autorité centrale
En vertu de l’article 8 de la convention de la Haye, le parent qui allègue que son enfant a été déplacé en violation de son droit de garde peut saisir soit l’Autorité centrale de la résidence habituelle de l’enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, en vue qu’elles lui prêtent assistance pour le retour de l’enfant. En France, l’autorité centrale est le bureau de l’entraide civile internationale.
Vous devez alors constituer un dossier avec toutes les informations utiles tendant à prouver le déplacement de l’enfant et l’identité à la fois du parent demandeur au retour, de l’enfant et de la personne qui a déplacé l’enfant.
La demande doit être complétée de toute décision qui aurait été rendue en ce qui concerne l’enfant et, si-possible, d’une attestation de l’Autorité centrale de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement évoquant la teneur du droit applicable en ce qui concerne la violation alléguée du droit de garde.
Attention, l’autorité centrale demande souvent une traduction des documents présentés à l’appui de la demande, dans la langue du Pays dans lequel a été emmené l’enfant.
L’Autorité centrale saisie d’une demande de retour d’un enfant déplacé illicitement transmet sans délai la demande à l’Autorité centrale de l’Etat sur le territoire duquel l’enfant a été déplacé.
Dès réception de celle-ci, l’Autorité centrale de l’Etat dans lequel se trouve l’enfant doit prendre les mesures qui s’imposent pour favoriser une remise volontaire de l’enfant.
Si la remise volontaire est refusée, l’Autorité doit alors saisir immédiatement le juge de l’Etat requis d’une demande visant à ce qu’il soit statué sur le retour de l’enfant.
La convention prévoit, dans le cas où l’enfant a été déplacé depuis moins d’un an au jour où la demande de retour est introduite, que l’autorité saisie est tenue d’ordonner le retour immédiat de l’enfant, même s’il est soutenu que celui-ci est intégré dans l’Etat requis. L’autorité judiciaire saisie de la demande doit normalement statuer dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.
Attention : la seule décision que peut prendre le juge de l’Etat dans lequel l’enfant a été déplacé est une décision statuant sur la demande de retour, non pas sur le droit de garde de l’enfant, (hormis les exceptions visées à l’article 10 du règlement Bruxelles II bis).
Par ailleurs, le Règlement Bruxelles II Bis, qui complète la convention de la Haye, énonce (Art. 11) que lorsqu’une demande de retour est formulée, il convient :
⦁ de veiller à ce que l’enfant puisse être entendu lors de la procédure sauf si son audition n’apparaît pas appropriée au regard de son âge ou de son degré de maturité.
⦁ que la juridiction saisie agisse rapidement « en utilisant les procédures les plus rapides prévues par le droit national ».
Le juge, qui rend une décision de non-retour en vertu de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980, doit la transmettre, dans le délai d’un mois, à l’autorité ou au juge de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle, immédiatement avant son déplacement, afin qu’il puisse être statué sur les questions relatives à « la garde de l’enfant ».
En conséquence, il se peut qu’il y ait deux décisions contraires à savoir une décision de non-retour et une décision par le juge de l’Etat dans lequel l’enfant disposait de sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement de fixer la résidence de l’enfant au domicile du parent qui a demandé le retour. Dans un tel cas, il convient de savoir que la décision relative au droit de garde de l’enfant prime la décision de non-retour étant précisé que l’exécution de la décision afférente au droit de garde peut s’avérer difficile dans l’Etat duquel l’autorité compétente a refusé de faire droit à la demande de retour.
Enfin, il convient de noter que l’Autorité, qui reçoit une décision de non-retour, doit la notifier aux parties qui ont trois mois pour présenter leurs observations en vue qu’il soit statué sur la garde de l’enfant.
Dans quels cas, peut-il y avoir un non-retour ?
La convention de la Haye prévoit (Art. 13) que l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne qui s’oppose au retour établit :
⦁ que le parent demandeur au retour n’exerçait pas, de façon effective, le droit de garde lors du déplacement de l’enfant, ou
⦁ qu’il a consenti postérieurement à ce déplacement, ou
⦁ qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou
⦁ que le retour de l’enfant le placerait dans une situation intolérable.
La convention prévoit également que l’autorité judiciaire saisie de la demande de retour peut refuser de l’ordonner si elle constate que l’enfant s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il s’avère approprié de tenir compte de son opinion.
Attention toutefois, même si le parent ayant déplacé l’enfant, établit que le retour de celui-ci l’expose à un danger grave ou à une situation intolérable, le juge du retour est tenu, aux termes de la convention Bruxelles II Bis, d’ordonner le retour s’il s’avère que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer sa protection après son retour dans le pays où l’enfant disposait de sa résidence habituelle.
Si vous êtes confronté tant en qualité de victime qu’auteur à la situation d’un enlèvement international d’enfant, n’hésitez pas à vous faire assister par un avocat droit de la famille Lyon formé et compétent. En contactant le cabinet STEFANIA, vous faites le choix d’un service de qualité par un avocat d’expérience.